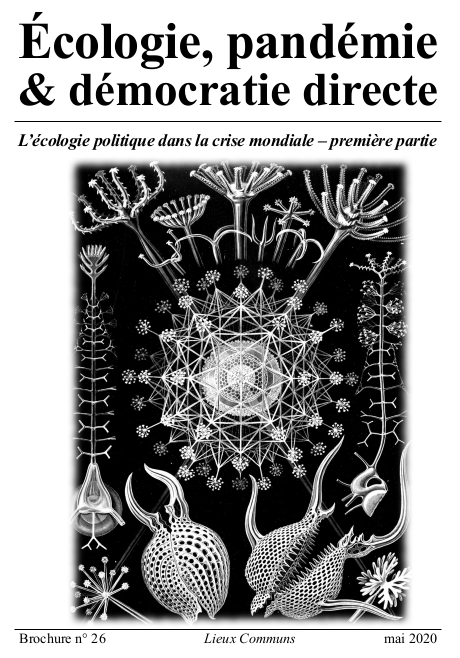Ce texte fait partie de la brochure n°26 :
« Écologie, pandémie & démocratie directe »
L’écologie politique dans la crise mondiale — première partie
Sommaire :
- Écologie et démocratie directe (Conférence) — Ci-dessous...
Transcription enrichie de l’intervention faite au groupe « Décroissance Île-de-France » le 4 octobre 2018. La discussion qui l’a suivie a été intégrée dans le propos. Texte initialement publié sur le site « Décroissance Île-de-France ». Quelques notes ont été rajoutées lors de sa mise en ligne sur notre site.
Les rapports entre la démocratie directe ou, plus généralement, un projet politique radical, et l’écologie sont à la fois complémentaires et contradictoires. Complémentaires, d’abord, parce qu’elles sont issues d’un même tronc historique, celui de tous les mouvements visant à une remise en cause radicale des sociétés occidentales. Pour être plus précis, les préoccupations écologiques sont réellement nées dans le bouillonnement des mouvements ouvriers concernant la santé, l’habitat, l’alimentation, la destruction des modes de vie. Ce sont par exemple les communautés rurales anarchistes du début du siècle en France. L’écologie politique des années 70 vient donc prolonger, approfondir, réinventer, radicaliser les grands courants contestataires de l’époque. Mais, et c’est là que ça devient compliqué, l’écologie s’est depuis peu à peu autonomisée de cette matrice, à mesure que la société s’est dépolitisée, pour faire vite, et que la situation écologique s’est dramatiquement détériorée. On se retrouve donc aujourd’hui avec une écologie « pour elle-même » en quelque sorte, avec une urgence très naïve de « sauver la planète » qui peut être très militante, millénariste voire quasi-militaire, mais qui constitue aussi le contenu des bavardages gouvernementaux et des instances internationales, et de l’autre une écologie politique plus conséquente mais qui reste peu ou prou dans la nébuleuse de l’imaginaire gauchiste, je pense notamment aux « décroissants » [1].
Mon intervention de ce soir sur le thème « Écologie et démocratie directe » va consister justement à essayer de renouer quelques-uns de ces fils, en essayant de ne pas trop répéter ce qui a déjà été dit [2]. Je pense que je ne vais rien apprendre à personne, surtout à vous, je vais juste poser quelques repères en rappelant quelques évidences, des lieux communs que très peu de gens, à ma connaissance et à ma grande consternation, formulent. Je vais aller, logiquement, du plus simple au plus complexe, sachant qu’il me sera impossible d’épuiser un sujet aussi énorme et qui mériterait des travaux infiniment plus conséquents.
Écologie et mouvements sociaux
Je commence par le terrain des luttes. Une des raisons à mon avis de l’échec des mouvements écologistes, échec non seulement à infléchir la course de notre civilisation mais surtout échec à tenir un discours politique susceptible de rassembler et de faire entendre d’autres perspectives, est imputable à la situation idéologique. En gros, l’écologie politique est aujourd’hui prise entre deux feux : soit faire le constat de l’épuisement global des ressources et prôner une « sobriété », mais alors nous accompagnons l’oligarchie dans son entreprise de pillage qui amène une baisse des niveaux de vie à son profit ; soit combattre cette même oligarchie, mais alors nous épaulons tous les courants contestataires qui ne sont en fait, comme le dit G. Fargette que des « mouvements-veto », des tentatives de sauvegarder coûte-que-coûte la société de consommation et de l’étendre à toute la planète… Par exemple la grande affaire des réformes successives du régime des retraites : elles se font évidemment sur fond de prédation oligarchique (extension des régimes privés, des fonds de pension, etc.) mais le régime actuel n’est tenable qu’à condition de maintenir une croissance à plus de 2 %, comme le proposait le camarade B. Friot… À Lieux Communs, nous avions distribué pendant les manifs de l’automne 2010 un tract prônant l’égalité du montant des retraites pour tout le monde [3]. Sans montant mais on peut estimer qu’avec une retraite presque équivalent au Smic, c’est vivable, et cela impliquerait évidemment une égalité de revenus généralisée. Ce n’est pas de la provocation, même si ça a l’air utopique. C’est un moyen de combattre, au moins au niveau du discours, l’oligarchie en tant que strate fascinante par son hyper-consommation tout en intégrant la baisse inéluctable du niveau de vie actuel. S’il doit y avoir austérité, qu’elle soit pour tout le monde.
En tout cas, c’est une position qui fait discuter, sur des bases nouvelles, même si c’était une vieille revendication du mouvement ouvrier. Et je m’étonne que personne ne s’y tienne, un tant soit peu. Là, il me semble que l’on est en plein dans le domaine politique tout en intégrant complètement la question écologique – bien plus en tout cas qu’avec l’infâme « revenu de base » [4]… C’est un exemple, mais il me semble bien montrer à la fois l’abandon de la politique proprement dite par les écologistes et la possibilité, qui existe, de renouer avec la réflexion politique. Évidemment, ce n’est pas une formule magique : sa mise en œuvre pose beaucoup de questions, qu’on aborde d’ailleurs dans une de nos brochures. Elle exige la mise en place d’une démocratie directe, dont elle est un pendant organique, ainsi que d’une redéfinition des besoins, donc la discussion sur ce que nous produisons et comment. Bref, c’est loin d’être une panacée. Mais la proposition n’est même pas discutée, ou même évoquée… On me dit que ce n’est pas populaire. Mais qu’est-ce qui est populaire aujourd’hui ? La décroissance et la simplicité volontaire ? Je ne crois pas. C’est plutôt Mbappé qui l’est, avec ses millions et sa gloriole. Je crois qu’il faut se résoudre à occuper la place de Cassandre : elle n’est pas écoutée, mais elle dit vrai. Donc disons vrai, ce que nous pensons, ce que nous voulons, ce que nous proposons, tenons-nous-y sans chercher, à tout prix, une popularité de toute façon éphémère et faisandée. Prôner la démocratie directe, c’est parler à des adultes, d’emblée, mettre la fin dans les moyens. C’est loin d’être simple et facile, mais c’est la seule perspective que nous voyons.
« Avenir radieux » et catastrophisme
Un spectre hante l’écologisme, c’est le catastrophisme. Je n’entends pas par là la conscience de ce qui est en train d’advenir – dans tous les domaines, comme l’oublient systématiquement les écologistes – mais bien une idéologie particulière très répandue qui se délecte sadiquement des cataclysmes actuels et à venir et annonce qu’il est trop tard, de toute façon, et après nous le déluge. C’est très présent dans l’industrie du spectacle depuis les films-catastrophe des années 70 (je viens seulement de voir « Le syndrome chinois » de 1979 qui envisageait la fusion d’un réacteur nucléaire). Impossible de zapper à la télévision sans tomber sur une série post-apocalyptique, des survivalistes en pleine action, une fiction sur la chute d’un météorite, les ravages d’un virus, un déferlement de zombies, et plus un seul documentaire animalier ou film de science-fiction – qui tient lieu aujourd’hui de seule vision tangible de l’avenir – sans toile de fond « éco-catastrophique ». Nous vivons dans ce discours qui nous dit : « Au fond, à quoi bon, consommons » et, à la limite active la fibre mégalo-sadique en faisant de nous les dernières générations de l’espèce… Évidemment, c’est invivable, surtout si on a des enfants, mais c’est simplement l’idéologie de rechange lorsque cède le « présentisme », ce sentiment ancré que tout va continuer, quoi qu’il arrive, que nous sommes à la fin de l’histoire et que plus rien ne peut se passer. C’est une sorte de dialectique idéologique qui permet de conjurer le doute, l’angoisse, le conflit intérieur, la peur du changement, la « terreur de l’histoire » dont parle M. Eliade… C’est largement audible lors de discussions : je me souviens avoir été pris en stop il y a une dizaine d’années en partant de Grenoble par un couple de jeunes ingénieurs chez Minatec, le grand complexe des nano-technologies. Comme je venais directement de chez des militants anti-Minatec, la discussion allait être intéressante… Au fil des trois ou quatre heures du trajet (dans le feu du débat, ils avaient rallongé mon transport), ils étaient passés brutalement de la défense incorruptible de leurs dogmes scientistes à la résignation à l’apocalypse, sur l’air de : « si on va par là, il n’y aura bientôt plus de banquise, nous respirons tous de la radioactivité et avalons des pesticides, alors au point où on en est, hein… »
Bref, pas facile dans ce contexte morbide, à la fois catastrophique et catastrophiste, les deux se nourrissant, de proposer un projet de société. D’autant plus que lorsqu’on en pose un, comme dans la brochure « Ce que pourrait être une société démocratique » [5], les gens s’attendent à ce qu’on les fasse rêver ; « on veut bander » m’avait-on dit un jour… Donc si avenir il y a il doit être radieux, dans la grande tradition millénariste, sinon c’est la fin du monde. C’est vraiment l’infantilisme le plus primaire… Lorsqu’on avance le projet de démocratie directe, on tente d’échapper à ça par la lucidité : l’avenir va être compliqué – et plus on tarde, plus il le sera, à tous points de vue – mais possible. On dénote dans cette époque où plus personne « ne veut se prendre la tête » – mais se « prend le chou » à longueur de journée en 140 caractères ! – et, ça tombe bien, le divertissement s’occupe de nous la prendre, notre tête, et de nous faire oublier nos angoisses, nos doutes, notre difficulté à vivre, les affres de la discussion contradictoire, la finitude, etc. Et le milieu écologiste n’est pas étanche à tout ça, loin de là. L’avenir radieux est assimilé à la « nature » à préserver, le jardin d’Éden, et le catastrophisme est étayé par toutes les nouvelles qui nous proviennent « du dehors ». Peu de place pour la réflexion, encore moins politique, alors que, quoi qu’il en soit de l’avenir, s’il y a encore quelque chose à faire aujourd’hui, ce qui n’est pas certain, c’est politiquement. Ou alors on se fait plaisir, mais alors il faut le dire… Bien sûr on peut combattre tel ou tel aspect de nos sociétés (ici contre le nucléaire, là pour l’agriculture bio, ici contre le transhumanisme ou la transition énergétique, les Grands Projets Inutiles, etc) mais sans projet d’ensemble, on ne fait que rafistoler et aiguillonner les politiques oligarchiques. Je suis surpris qu’on ait oublié si vite cette évidence que nous vivons dans un système qui récupère tout ce qui lui permet de perdurer et que, sans perspective, sans fil rouge qui nous guide, sans travail de fond et sans dynamique populaire, bref sans projet de société, nous sommes bringuebalés, trimballés, chahutés sans cesse, dupés décennie après décennie. Je sais que ce n’est pas facile, que l’époque est apolitique au possible, mais c’est bien pour ça que ce n’est pas fait – et que c’est à faire…
La question du travail
Autre aspect du rapport entre démocratie directe et écologie, celui du travail, lié au point précédent. Je ne vais pas revenir sur la question du revenu de base ou revenu d’existence, je renvoie au livre collectif sur le sujet. Mais cette perspective d’un avenir où il y aurait moins de travail me semble vraiment une déréalisation totale, là on est vraiment dans l’« avenir radieux ». Il faut être un peu lucides sur tout ce qui sous-tend notre niveau de vie, notre mode de vie contemporain : ce sont des nuées d’esclaves mécaniques (plus de 150 je crois), toutes les machines domestiques ou industrielles, sans même parler des modes de fabrication de ce que nous consommons, ici ou à l’étranger. Et toute cette mégamachine repose sur quantité de ressources en métal, en énergie, en matériaux divers (terres rares, etc.) et si l’on se tient véritablement à une fin, ou en tout cas une attrition des ressources, le peak all, il y en aura moins, bien moins, réservées aux fonctions les plus vitales (hôpitaux, armes, etc.). Il va falloir revenir à la force animale ou humaine, et même en supprimant tous les secteurs parasitaires, je ne sais dans quelle proportion. Tout cela pose aussi beaucoup de questions, certaines fausses, d’autres grandes ouvertes, mais qu’on ne peut pas aborder ici de toute façon.
L’une d’entre elles concerne directement la démocratie directe. On m’objecte très souvent que la démocratie directe en Grèce antique n’était possible que parce que c’était une société d’oisifs grâce à l’esclavage, et donc que la perspective que je dessine d’un retour du travail rendrait la démocratie impossible. Je ne vais pas entrer dans le détail sur la Grèce mais là on est vraiment dans la mythologie, sans jeu de mots : un peuple d’oisifs n’est pas un peuple de combattants, comme l’étaient les Grecs qui ont inventé la conscription. C’était un peuple de paysans, d’artisans, de commerçants et tous remplissaient régulièrement l’Ecclesia, l’assemblée d’Athènes. Quant à l’esclavage, il était généralisé partout à l’époque, sans permettre la démocratie, ni en Perse, ni en Égypte, ni en Chine, etc. Mais sur le fond de l’affaire, il faut parler des mouvements ouvriers et même avant des bourgeoisies révolutionnaires : tous étaient des travailleurs, sans esclaves, et ils ont littéralement réinventé la démocratie directe, dans les villes franches du XIIe siècle, dans les sections révolutionnaires de 1789 et plus encore dans toutes les institutions des mouvements ouvriers, les mutuelles, les coopératives, les proto-syndicats, etc. Et eux travaillaient plus de dix heures par jour. Leur auto-formation, leur auto-alphabétisation se faisaient le soir, la nuit, à la lueur des bougies et des lampes à huile… Quand aujourd’hui j’entends que les gens n’ont pas le temps de faire de la politique et qu’il leur faudrait un revenu d’existence, j’ai envie de hurler… Plus de trois heures par jour et par personne de télévision, sans compter le temps devant le smartphone ou les tablettes à jouer à Candy crush… Je veux bien qu’on soit harassé après une journée de labeur, ça m’arrive, pris dans les imbroglios administratifs, les problèmes de famille ou de voisinage, de santé, etc., mais tout de même… On parle de bore-out et le temps libre est devenu un marché très rentable… Il y a beaucoup de mauvaise foi, là… Ce qui fatigue – et notre civilisation est fatiguée – c’est la passivité, c’est subir notre existence, c’est la pseudo-impuissance, certainement pas l’activité libre et autonome, a fortiori collective.
Démographie
Lorsqu’on parle de la Grèce antique, on entend souvent l’objection de l’échelle démographique, petite à l’époque, monumentale aujourd’hui. C’est à la fois vrai et faux. C’est faux parce que ce n’est pas parce qu’on est très nombreux qu’il est impossible dès aujourd’hui d’instituer une démocratie directe localement, par exemple dans les villes de moins de 20 000 habitants, et d’articuler une coordination entre elles, par exemple à l’échelle de la région, selon des modalités de tirage au sort, par exemple (c’est en partie ce que l’on propose dans notre projet). Bien sûr c’est loin d’être simple.
Mais la question démographique mérite aussi d’être abordée en elle-même. Je suis toujours extrêmement surpris du tabou qu’elle soulève dans les milieux écologistes. Il s’explique, bien sûr, par l’héritage de Malthus, le chantage à la « dérive droitière », etc. Mais aussi désagréable soit-elle, il n’y a que l’écologie qui peut la poser clairement. J. Diamond a raison en disant qu’on peut dégager de toutes les problématiques écologiques deux facteurs fondamentaux : la démographie et le mode de vie, qui doivent s’équilibrer. Et il faudrait diminuer soit l’un soit l’autre, les deux dans l’immédiat. Le mode de vie semblant non négociable, y compris et surtout par ceux qui y aspirent, soit les trois quarts de la planète, il faudrait agir sur les naissances. Cela rentre en contradiction frontale avec le dynamisme économique, dont on nous rebat les oreilles, et dont on se sert pour rendre indispensable l’immigration en Occident… Il y a là toute une machinerie idéologique, plus complexe qu’il n’y paraît, qui accélère le pillage du tiers-monde et entretient la croissance occidentale, qu’il faudrait démonter.
Mais là, encore plus que pour la démographie, l’immigration – ou plutôt ce que l’on appelle encore ainsi alors que le phénomène a changé de nature [6] – est un tabou presque absolu, rarement ébréché ou, si c’est le cas, sans suite – je pense au courageux livre de M. Sourouille [7]. On sermonne sur le consumérisme sans vouloir voir que la majorité des immigrés sont là pour ça : la société de consommation… Je ne vais pas m’étendre sur la question, mais on voit là comment l’écologie qui se veut politique n’est en réalité pas politique du tout et ne fait que reconduire les absurdités gauchistes lorsqu’elle ne se cantonne pas à ce qu’elle croit être « son » domaine, l’écologie, l’environnement, la nature, le climat, les extinctions massives, etc. Vous avez compris que l’écologie ne peut se satisfaire de sa « niche écologique » et doit au contraire s’insérer dans la réflexion politique, en la reprenant radicalement. Cela veut dire pouvoir se prononcer sur tous les phénomènes identifiés tels. L’avantage insigne de l’écologie, c’est qu’elle pourrait le faire d’un point de vue relativement nouveau, donc en renouvelant les approches classiques, hors des sentiers battus. Le choix d’une écologie « de gauche » décidé dans les années 80 a certes été un succès électoralement parlant et de manière très éphémère, mais une calamité pour le mouvement et au-delà pour l’avenir. Ce sont des décennies perdues et nous revoilà au point zéro, ou presque. Il y aurait à refonder une politique. Il me semble que l’angle qu’offre la démocratie directe est éminemment fertile, pour peu qu’on veuille bien en saisir la portée et la complexité.
Écologie et politique
Je vais tenter d’approfondir un peu cette question de la complexité. Je fais partie de la première génération à avoir été élevée avec et dans les « problèmes d’environnement » : à la toute fin des années 80, il était essentiellement question de la déforestation, des filets dérivants, de Tchernobyl, du trou dans la couche d’ozone et de pluies acides. Tout cela a accouché, vous le savez mieux que moi, sur l’oxymore du « développement durable », et l’écologie apparaissant comme se substituant à la politique, décrite comme obsolète suite à l’effondrement du bloc de l’Est.
Mais pour qui s’est intéressé au sujet apparaît rapidement que les questions relatives à la « protection » de la nature, ou sa « préservation » ou sa « gestion », n’ont aucun sens : il n’existe pas de « nature » à proprement parler, pure, sauvage, intacte que la méchante société humaine souillait, détruisait, violait. Les soubassements psychanalytiques de ce schéma infantile sont évidents et se heurtent à la réalité : la « nature » étudiée du point de vue scientifique n’a rien d’une harmonie, c’est une auto-organisation en perpétuelle métamorphose, en évolution, qui n’a rien de bienveillante ou de belle en soi. Ceux qui, comme moi, ont été adeptes du camping sauvage, c’est-à-dire savent ce que veut dire quitter le nid douillet d’où on rêve de primitivisme, comprennent ce dont je parle. La plupart d’entre nous ne seraient pas là sans la médecine moderne, les techniques agricoles, le savoir scientifique, bref, la société humaine telle qu’elle est. La nature, ce n’est pas que l’air « pur » et les belles photos ; c’est aussi quand vous tombez malade, que vous êtes perdus en mer, que votre enfant naît handicapé, lorsque vous mourrez de faim ou que votre maison est bouffée par les termites.
Par un mouvement de balancier dont l’histoire a le secret renaît aujourd’hui le mythe absurde d’un être humain qui serait être de nature et non de culture, qui ne serait à la limite qu’un animal parmi d’autres – dans ce cas pourquoi lui demander plus qu’aux autres et notamment de protéger ces « autres » ? C’est malheureux d’avoir à rappeler que l’humanité s’est construite ontologiquement contre la nature, au sens large. Au fil des millénaires, Homo sapiens a énormément détruit – la mégafaune du pléistocène aux Amériques, par exemple, la plupart des espèces insulaires ou plus tard toutes les forêts du bassin méditerranéen –, domestiqué – presque tout ce que nous mangeons est issu de millénaires de sélection génétique empirique –, asservi, aménagé – notamment la forêt amérindienne par les techniques d’abattis-brûlis, que l’on présente toujours comme le parangon de la nature « vierge » de toute influence humaine. Où que vous regardiez, le paysage, aussi sauvage paraît-il, a été modelé par l’activité humaine, et les quelques exceptions ont été influencées : on retrouve par exemple des dépôts d’industries de métallurgie antiques dans les strates glaciaires des pôles… Bref l’environnement et les sociétés humaines ont toujours été étroitement liés, on parle de phénomène de coévolution. L’environnement naturel tout comme notre propre organisme ont été modelés, plus ou moins bien sûr, par notre action depuis des millénaires. Et ça continue, avec une accélération sans précédent et évidemment selon des modalités radicalement nouvelles depuis l’ère industrielle et l’explosion démographique du XIXe.
À partir de là, la question n’est plus celle de la « conservation » de la « nature », mais du monde dans lequel nous voulons vivre. Pourquoi, finalement, ne pas vivre sur une planète entièrement artificialisée, avec seulement quelques milliers d’espèces indispensables à la survie de 15 milliards d’êtres humains ? Ou dans des mégalopoles entourées d’une nature sous cloche, pour les promenades du dimanche ? Pourquoi ne pas en revenir au mode chasseurs-cueilleurs avec 300 millions d’humains ou, comme les Amish, s’arrêter à un stade pré-industriel ? Pourquoi vouloir, comme cela est courant aujourd’hui, un « maximum » de biodiversité (comme si une extrême « diversité » était bonne en soi, ce qu’elle n’est ni dans les écosystèmes ni dans les sociétés humaines) ? Rien de tout cela n’est inscrit nulle part, et certainement pas dans une « nature » ou une vie biologique qui n’a aucune autre finalité que de s’étendre partout par tous les moyens et qui ne propose aucun modèle univoque d’organisation (le fonctionnement d’une cellule n’est pas celui d’un organe qui n’est pas non plus celui d’un organisme ni d’un écosystème ni de la biosphère ; et la mystique de « l’auto-organisation » n’en dit rien). En réalité, nous sommes en face de la question politique : quel monde veut-on, donc dans quelle société veut-on vivre, avec quelles valeurs, quel sens à l’existence et notamment quel rapport avec le vivant, le « sauvage », le non-maîtrisable, l’irrationnel ? Qui décide, de quoi, avec qui, pour qui, au nom de quoi et en vue de quoi ? Toutes les perceptions de notre environnement sont construites culturellement : selon notre éducation, une forêt est belle, utile, dangereuse, indispensable, mortelle ou fragile, cela change selon la latitude, la longitude, l’époque, la classe sociale, etc. La question écologique se fond, aspects scientifico-techniques sur lesquels je vais revenir mis à part, dans la politique entendue comme l’organisation des humains entre eux.
Je suis désolé de poser des évidences, des lieux communs, mais c’est un aspect qui est à la fois totalement trivial et systématiquement éludé. L’écologie, même à notre corps défendant, prétend au fil des décennies en prendre le relais et s’émanciper de la question politique, mais celle-ci reste princeps, qu’on le veuille ou non. Et je suis consterné par cet escamotage de beaucoup de militants. Je ne généralise pas : certains se servent de cette porte d’entrée pour amener les nouvelles générations à la politique, mais force est de constater que la réflexion politique des écologistes rejoint celle de nos sociétés contemporaines : elle est à peu près nulle. Cela s’explique, évidemment, par le phénomène de « dépolitisation » généralisé, en réalité le retrait récent des peuples de la marche de l’histoire, alors qu’ils l’ont faite en Occident pendant des siècles. L’aboutissement de ce processus a été le naufrage du XXe siècle, et l’invention des totalitarismes, au nom du bien commun, bien entendu, qui fait que nous évoluons dans des ruines, des vestiges. Notre paysage politico-intellectuel est, à l’image de notre planète, dévasté. En réalité, c’est bien cette poussée populaire titanesque vers la démocratie directe qu’ont incarné des Lumières jusqu’aux mouvements ouvriers ou féministes, c’est-à-dire la participation du plus grand nombre à toutes les décisions qu’il s’agirait de reprendre. Et de reprendre, si l’on veut, au nom de l’urgence écologique, c’est ce que je prétends faire aussi, mais cela ne veut pas dire, surtout pas, faire primer le biologique sur le politique mais au contraire radicaliser la critique politique, et c’était l’ambition initiale de « l’écologie politique ». Radicaliser mais surtout réinventer et je crois que le mot n’est pas rhétorique parce que l’écologie politique pose des questions à la fois nouvelles et absolument essentielles que nous ne pouvons plus éluder, concernant notamment la science, la connaissance scientifique, la rationalité.
Écologie et sciences
Rien que le terme d’« écologie politique » est contradictoire et je crois que c’est une de ses butées en même temps qu’un de ses intérêts. Contradictoire parce que l’écologie est avant tout une science, née à la fin du XIXe siècle. Et une science, c’est le contraire exact d’une politique. La politique, c’est le règne de l’opinion, de la doxa, de l’avis, du désir, du choix, du projet. On l’a vu, rien de transcendant ne peut nous aider à organiser la société : pourquoi ne pas exclure les femmes de la sphère publique, comme cela a été le cas pendant des millénaires, ou généraliser l’androgynie ou la bisexualité ? Pourquoi ne pas suivre les prescriptions politiques du Coran, scarifier les adolescents, se débarrasser des vieux ou construire des pyramides ? Pourquoi instaurer une démocratie directe plutôt qu’une monarchie ou une gérontocratie ? Etc. Notre monde humain est fondamentalement culturel, anthropologique, arbitraire en un sens. Bien sûr il y a des contraintes, géographiques, écologiques, biologiques, anatomiques, mais la question de leurs implications et déterminations se pose pleinement – c’est d’ailleurs en partie ce dont nous discutons.
La science, au contraire de la doxa, de l’opinion, est une épistémè, un savoir qui se veut exact, qui se réclame d’un autre monde que le monde humain. Je ne vais pas rentrer ici dans les questions d’épistémologie, en réalité de philosophie : bornons-nous à admettre, à rebours du post-modernisme, que la science, occidentale, rend compte d’une partie de la réalité, qu’elle n’est pas (encore !) juste une croyance tribale parmi d’autres, mais qu’elle recouvre effectivement un pan de la réalité extérieure au psychisme humain, du réel comme on dit. C’est d’ailleurs la position minimale des écologistes militants, puisque leur approche dépend de mille manières de la science écologique, je vais justement y venir. L’important est qu’une science est un savoir construit sur la logique, la rationalité, une méthodologie, une approche hypothético-déductive, le régime de la preuve, etc. indépendamment, en théorie, de toutes les orientations idéologiques, affectives, subjectives du chercheur. On voit que cet univers-là n’est pas celui de la politique.
Cette dichotomie doxa / épistémè, les grecs l’avaient déjà identifiée comme opposition nomos / physis, le monde de la loi humaine, de la convention, de la culture et de la politique et celui des lois naturelles, physiques, biologiques. Ce n’est pas un hasard que cette distinction soit née dans la seule civilisation connue qui ait pratiqué la démocratie directe : si on n’exclut pas la nature de la politique, on ne fait pas de politique au sens où nous l’entendons, on ne fait qu’obéir – pour nous : croire obéir – à un ordre extérieur, forcément indiscutable, celui des esprits des animaux et des plantes, des forces de la nature, des ancêtres plus ou moins réincarnés, des Dieux ou de tous ceux qui prétendent incarner l’ordre cosmique éternel, fût-il cyclique. Ça a l’air exotique tout ça, mais ça ne l’est pas du tout : c’est ce principe que l’on a retrouvé dans les totalitarismes, qui se sont tous réclamés de l’épistémè, de la physis, de la science. C’est le bolchevisme qui s’est réclamé de la « Science de l’Histoire », du matérialisme historique, du marxisme-léninisme. Un marxiste conséquent (il n’y en a plus guère, heureusement) sait le sens de la destinée humaine, il a percé « scientifiquement » les secrets de l’évolution humaine (merci Hegel) et son aboutissement ultime. Cela a donné évidemment une dévastation sans nom, une des plus originales et sinistres inventions de l’humanité. Voilà ce qui arrive lorsqu’on pense que la science de la nature doit se faire politique. La chose est encore plus claire, et plus près de ce dont nous parlons, avec son rejeton le nazisme, qui se réclamait de la biologie humaine et de la lutte des races.
Mais la confusion entre physis et nomos n’appartient pas à l’histoire : nous ne vivons évidement pas dans des régimes totalitaires, mais c’est aujourd’hui la « science » économique qui préside à presque toutes les décisions politiques, c’est ce que l’on appelle le capitalisme. C’était aussi l’erreur de Marx, contaminé par l’idéologie de son époque, de penser que l’essence du social était économique – ou plutôt technique – depuis la préhistoire. Et, avant lui, celle de Platon, au fond, avec son « philosophe-roi », comme si, toujours la même chose, la politique pouvait être une science exacte que l’on pouvait détenir pour les autres, afin de décider à leur place. Tout cela est donc très ancien, à la fois très profond et très présent, et renvoie au rapport plus général avec la non-rationalité ou alter-rationalité de la politique telle que nous l’entendons, l’auto-fondation de l’humanité, l’auto-organisation des gens, l’auto-institution de la société pour reprendre l’expression de C. Castoriadis.
Je pense que vous voyez où je veux en venir : l’écologie est une science (passionnante, j’en suis toujours amoureux au demeurant) mais c’est aussi une politique. Tout ce dont se réclament les écologistes, tout ce qu’ils savent, ils le savent de la science : la toxicité des perturbateurs endocriniens autant que les conséquences de la radioactivité sur le génome, la mise en danger de telle espèce autant que les effets géologiques ou pédologiques probables de la disparition des glaciers. C’est là le paradoxe des écologistes contemporains : leur amour de la nature peut leur faire mettre la science au centre de la politique, éloignant plus encore les gens de leur perception immédiate et de leur capacité de décision. Il s’en faut de peu pour que l’écologie en tant que science de l’organisation du vivant se substitue à l’organisation de la cité. Le danger est tellement visible que l’on parle depuis longtemps dans nos milieux d’un danger d’ « éco-fascisme ». On devrait plutôt parler d’éco-totalitarisme parce que c’est bien la gauche, plutôt que l’extrême droite, qui a inventé ce type de régime, la gauche avec tous ses bons sentiments et sa main sur le cœur. Et ce n’est pas une vue de l’esprit : les militants totalitaires, aujourd’hui, ce sont notamment les millénaristes végans ou anti-spécistes et plus généralement toute la bien-pensance qui impose des censures innombrables dans le débat public et le rendent impossible, au nom de la « tolérance » envers les minorités, les musulmans, les migrants, les homosexuels et consorts, etc. Ce politiquement correct infeste tout et doit être identifié comme un tropisme actuel vers le totalitarisme. Il n’est pas étonnant que les pays d’Europe de l’Est y résistent – prêtant le flanc à des réactions symétriques –, eux qui ont vécu des décennies dans cet enfer pavé de si bonnes intentions.
Revenons à l’écologie proprement dite : cette science peut-elle faire politique ? D’abord on n’en prend pas du tout le chemin : les scientifiques, par exemple du GIEC ou de l’IPBES, ne cessent de hurler à la catastrophe, et rien ne se passe véritablement, l’oligarchie continue son pillage, la maison brûle et ils vendent à la fois de l’essence et des extincteurs au plus offrant. Mais vous le savez mieux que moi : cela ne va pas continuer comme ça. On ne va pas faire de prévisions, mais si l’humanité s’en tire, elle vivra dorénavant sous d’énormes contraintes écologiques puisqu’on parle de processus très inertiels et de phénomènes imprévisibles. Dire, comme Paul Valéry, que « le temps du monde fini commence », ça veut dire ça, très précisément. Quel que soit le mode d’organisation des sociétés futures, y compris des campements nomades de survivants hagards, ils seront hautement dépendants des legs de notre époque industrielle et devront gérer leurs ressources au mieux. Je pense aux pollutions des sols, largement invisibles, à la radioactivité, aux espèces invasives ou au colmatage superficiel des puits de pétrole off-shore. Il me semble inévitable que la science écologique intervienne massivement dans presque tous les choix politiques, y compris intimes comme le contrôle des naissances. Mais cela peut se faire de plusieurs manières. La plus probable, si les peuples continuent de s’en remettre aux « autorités responsables », est l’émergence d’une techno-bureaucratie mêlant éco-ingénierie, sociobiologie, sciences cognitives et bio-technologies, qui se légitimerait en toute honnêteté de l’état de la planète, jugulant toute contestation. Devant ces perspectives peu réjouissantes, on comprend mal que les militants écologistes aient autant de réticences à se saisir de la question politique, alors que la pertinence dans ce cadre de la démocratie directe est peu contestable : l’expert y serait remis à sa place de consultant, mis en contradiction avec d’autres, confrontés eux-mêmes à d’autres disciplines et, au bout du compte, ce serait la souveraineté populaire qui aurait le dernier mot, en fonction du projet politique qui serait le sien. En l’absence de ce dernier, ce sont les blouses blanches, les lobbies, la résignation et le conformisme qui orientent tout… La démission des écologistes dans ce contexte socio-historique est une attitude compréhensible, particulièrement au vu de l’adhésion mondiale au consumérisme. Mais c’est irresponsable : on peut se féliciter que l’écologie soit dans l’air du temps, ait provoqué l’émergence de quelque chose comme une sorte de « conscience mondiale », mais comme tout cela n’est pas guidé par un quelconque projet politique crédible (je ne parle pas du greenwashing des vieux dogmes marxistes que sont presque toujours les éco-« socia-lismes », etc.), on est en droit de se demander à quoi tout cela va servir… On a vu que les meilleures intentions du monde pouvaient servir à faire advenir l’enfer sur Terre. Et ce n’est pas en pissant toujours plus à gauche que l’on va s’en prémunir, bien au contraire. Il y aurait à réinventer une véritable politique, hors des idéologies héritées qui ne servent plus qu’à entretenir un simulacre d’alternance électorale et de contestation.
Écologie et savoir scientifique
Mais tout cela est encore loin de résoudre la question car les mêmes problèmes se posent à autre niveau, beaucoup plus fondamental, où l’on voit que la démocratie directe est consubstantielle aux problématiques écologiques et les subsume. Je veux parler de la question de la science non pas comme opérateur politique mais comme régime de savoir dont j’ai déjà dit quelques mots. Vous connaissez tous la formule de K. Polanyi qui visait très justement à « ré-enchasser » l’économie dans la société, c’est-à-dire à cesser de considérer, comme le font les marxistes et les libéraux, l’économie comme un domaine à part déterminant tout le reste de la société, une sorte d’autorité extra-sociale quasi surnaturelle comme on envisage aujourd’hui les « marchés ». On pourrait dire exactement la même chose de la technique – ce que semblent oublier nombre de disciples de J. Ellul – mais aussi de la science. Dire qu’il y a autonomisation de la technoscience veut dire qu’elle n’a d’autre finalité qu’elle-même, indépendamment des besoins ou des projets politiques ou sociaux. Mais ça ne veut pas dire, ou alors on se trompe, qu’il s’agit là d’une instance réellement hors de la société, qui fonctionnerait indépendamment des rapports sociaux contemporains. Ce surinvestissement, cette « sacralisation » est purement ethnologique de notre point de vue et renvoie aux croyances de notre tribu.
C’est clair d’un point de vue historique, par exemple. Il n’existe de science que dans certaines circonstances particulières, c’est une espèce qui a besoin d’un milieu de vie très précis pour survivre et prospérer. Ce milieu, c’est une société ouverte, au moins partiellement démocratique, où l’individu jouit d’un minimum de liberté dans tous les domaines lui permettant de s’interroger, d’apprendre, de transmettre mais aussi de transgresser, de remettre en cause, de douter. Et ces conditions ne sortent pas du ciel, elles sont issues en Occident d’un long processus historique de plusieurs siècles de sortie de certains obscurantismes religieux, de formes d’autoritarisme politique, de crispations sociales et morales, etc. Ce processus a eu lieu passagèrement à différents degrés dans les grandes civilisations historiques, mais s’est vraiment épanoui dans l’Occident moderne à partir du XVe siècle – on peut voir par contraste où en est la science dans les pays musulmans actuels, malgré leurs énormes richesses ; après avoir entamé une modernisation durant le XXe siècle, une partie importante retombe dans les ténèbres religieuses, avec tout ce que cela entraîne. Émancipation individuelle et collective et interrogation rationnelle du monde marchent ensemble, ce sont deux branches issues d’un même tronc, et qui s’entrecroisent très intimement.
Donc la science est une plante qui a besoin d’un substrat social, politique, culturel et vous savez comme moi que ce substrat est en train de s’éroder à grande vitesse. Existe-t-il encore de la science aujourd’hui ? La discussion n’est pas facile et prendrait du temps, mais si l’on voit effectivement d’innombrables perfectionnements d’objets techniques, comme l’informatique ou les communications, les grands paradigmes de chaque discipline restent inchangés depuis au moins un demi-siècle, alors que les données qui les contredisent s’accumulent. Nous ignorons la nature de la majeure partie de l’énergie et de la matière dans l’univers, mais chacun à l’impression que la physique va bien… La situation est similaire en biologie où nous sommes incapables de remplacer le paradigme cybernético-informationnel qui ne rend plus compte du tout de ce que l’on observe à l’échelle de la cellule comme de l’organisme. Je ne parle même pas de la chape de plomb idéologique qui semble peser sur les recherches les plus polémiques sur la génétique humaine, l’épigénétique, etc. Cela rappelle fortement l’ex-URSS… Bref si l’on a toujours besoin de vraies sciences et de sciences écologiques tout particulièrement, et là c’est une question de survie de l’espèce, il faut, nous devons impérativement, maintenir une culture démocratique vivante dans les sociétés actuelles. Une culture, c’est-à-dire une pratique, une envie, un désir, une volonté de faire advenir, ou au moins de maintenir, un minimum d’information, de délibération et de souveraineté populaire avec tout ce que cela implique ; une tendance à l’égalité économique et politique, une liberté dans les mœurs comme dans les idées, un sentiment d’intérêt collectif, une identité commune, etc. C’est précisément de cela dont nous nous éloignons. Les scientifiques du futur risquent sinon de n’être plus que des technocrates formés à la falsification des données, au plagiat, à la fraude, financés par des lobbies voire vendus à leur clan qui leur assure une carrière, d’ailleurs de plus en plus précaire…
Et tout cela est encore plus vrai pour l’écologie, vrai au carré. Pourquoi ? Parce que si on peut concevoir un mathématicien génial retiré dans son ermitage à la Grothendieck ou à la Perelman, l’écologie est une science éminemment collective, et ce à mesure de l’étendue de son étude : si on parle de l’évolution globale de la biosphère, les interactions sont absolument innombrables, et on en découvre tous les jours, impliquant un nombre croissant de disciplines. Je pense aux bouleversements climatiques et à leurs impacts sur les courants marins, la croissance végétale, la modification des écosystèmes, l’épidémiologie, etc, etc. Ces processus étant pris dans des boucles complexes de rétroactions, bien évidemment… Science qui tend à l’hyper-complexité, donc. Mais, et c’est l’essentiel, si nous parlons de cette écologie globale, il faut également impliquer les sociétés humaines comme parties prenantes de plain-pied, c’est-à-dire les comportements humains, qui relèvent du domaine anthropologique regroupant la sociologie, l’ethnologie, la psychologie mais aussi le droit ou l’histoire. L’écologie est une science « impliquante ». Si vous voulez comprendre biologiquement un milieu naturel, quel qu’il soit, vous devez tenir compte de l’influence anthropique passée comme présente et qui est évidemment croissante avec le temps, directement (pêche, chasse, feux, récolte, pâture, piétinement, etc.) ou indirectement (pollutions, bruit, déchets, extinctions, introduction d’espèces…) et de son évolution. Toute mesure sur ce milieu aura ses répercussions sur la société qui, par ses pratiques, le faisait tel et inversement. On peut désigner telle ou telle espèce à protéger, si la pauvreté ou l’appât du gain pousse au braconnage ou à l’over-fishing, la mode au tourisme de masse destructeur, ou si telle usine n’entend pas renoncer à ses « externalités », vous allez faire du droit, de la géopolitique, de l’économie, de la psychologie… Plus fondamentalement, il faut que vous fassiez un grand détour par l’activité des gens dans leurs milieux et ce que l’on appelle leurs « savoirs profanes » sur la nature, qui la modèlent depuis des millénaires, qu’on aurait tort de négliger comme on le fait. Il ne s’agit pas seulement, ou pas uniquement, de leur « véracité » de leur « exactitude » du point de vue scientifique, même si on redécouvre la phytothérapie avec des éprouvettes ou les bienfaits du pâturage ou de la fauche sur la biodiversité. C’est que ces habitudes, ces réflexes, ces savoirs, ces représentations, ces mythes, ces traditions sont constitutifs de leurs cultures, de leurs existences même et, au fond, font partie de l’écosystème lui-même, que le chercheur doit appréhender en tant que quel. On chante inconsidérément les louanges de la biodiversité naturelle, mais on assiste en parallèle à une uniformisation des cultures humaines, sans comprendre que la seconde entre en contradiction violente avec la première. Tout cela pose une multitude de problèmes cruciaux, délicats mais aussi urgents : il ne s’agit pas de faire du primitivisme ni d’entretenir des zoos humains mais de parvenir à articuler différentes cultures les unes avec les autres et le tout dans une biosphère dont l’unité nous apparaît brutalement. Questions grandes ouvertes que renferment le règne de l’american way of life tout autant que l’environnementalisme naïf… On voit bien que l’écologie ici, en tant que science, interpelle immédiatement toutes les sciences sociales, et la politique. Et que cette dernière, toujours du point de vue du chercheur, doit être entendue comme la mise au centre de toutes ces petites gens qui doivent avoir voix au chapitre non d’un point de vue moral ni même politique, mais d’un point de vue épistémologique de « gestion des milieux ».
Tout cela ne sort pas de mon chapeau : ce sont les évidences auxquelles ont abouti toutes les mesures de simple « protection » de la nature – je pense notamment aux « parcs naturels » – butant à chaque fois sur une absence de politique digne de ce nom. Effectivement, impliquer tout le monde autour d’un territoire et de pratiques, c’est immédiatement demander aux gens de s’occuper des affaires publiques, donc de leurs propres affaires, et donc faire remonter tout ce que la politique représentative dans tous les domaines a enseveli, les trésors d’imagination et de lucidité tout autant que l’opportunisme ou l’infantilisme. Rassemblez dans une salle des bergers pour discuter de l’organisation des estives, ou des marins sénégalais et mauritaniens pour évoquer les quotas de pêches ou encore des urbains pour décider du devenir d’un terrain vague, et vous aurez toutes les contradictions sociales qui vont surgir d’un coup (l’assemblée va devenir « analyseur » comme on dit en psycho-sociologie) : on parlera d’un coup chefferie, délinquance, inégalités et adultère mais aussi projet, projections, fantasmes et idéologies… Rajoutez-y les politiques, les industriels, les touristes, les psychotiques, les sorciers locaux et les naturalistes et vous avez devant vous tous les enjeux de la démocratie directe que cache l’arbre de l’écologie politique…
Écologie et rationalité
On retrouve donc ici encore les postulats de la démocratie directe, mais à un niveau bien plus profond, et je finirai là-dessus. Nous sommes ici à la frontière du savoir scientifique, rationnel, logique, mathématisable qui exige, pour être mené à bien et au nom de sa propre recherche, de faire appel à une autre logique, et au moins de toute sa composante sociale ou culturelle, ou politique, au sens où je l’entends ici, et qui n’est pas de même nature. Le problème est ici d’arriver à reconsidérer les rapports entre physis et nomos, surtout pas d’abolir la frontière en absorbant l’un par l’autre comme le font le totalitarisme ou le post-modernisme chacun de leur côté, mais d’examiner le no man’s land de l’entre-deux, les modalités de passage de cette frontière, sa redéfinition selon de nouvelles lignes, etc. Le débat L. Ferry / M. Serres autour de l’écologie politique, qui a presque trente ans, ne semble pas avoir évolué d’un poil, entre d’un côté un modernisme orthodoxe caricatural et de l’autre l’ouverture à une autre chose, mais qui se confond aisément avec un retour à une situation pré-moderne hétéronome dont j’ai parlé, notamment chez un B. Latour… Cela exigerait de longs développements, impossibles ici, mais c’est une question absolument fondamentale, et dans toutes les disciplines, puisque un peu partout la civilisation occidentale bute justement contre l’impasse de la rationalité, de la raison, même. Et, parallèlement, contre la définition d’une autre logique, ou d’autres logiques… Dans ce qui ressemble à un cul-de-sac, on assiste presque systématiquement au développement d’un hyper-rationalisme d’un côté et de l’autre à un irrationalisme. C’est le cas de la psychologie, entre les approches comportementalistes et les innombrables chamanismes psycho-thérapeutiques ; ou de la médecine, entre le tout-moléculaire et la jungle des « médecines parallèles » ; mais aussi de la sociologie, entre le tout-quantitatif à la Bourdieu et l’ethnométhodologie d’un Garfinkel ; etc. Même chose en politique, avec des automatismes bureaucratiques maintenant informatisés à toutes les échelles, et des pulsions insurrectionnelles anomiques. Il y aurait à reprendre tout ça, qui a été pas mal discuté dans les décennies 70-80, plus du tout aujourd’hui, alors même que ces deux pôles se croisent dans la plus grande confusion… Nous vivons dans une sorte de « soupe primitive » civilisationnelle, comparable à celle des empires hellénistiques, d’où est sortie la régression chrétienne. Je n’évoque pas cela par hasard : notre époque est traversée d’élans très irrationnels, où se bousculent les croyances et les superstitions millénaires ou bricolées, les complotismes et les mysticismes les plus improbables, dans un chaos anomique ou « polynomique » [8]. Et cela va de pair avec l’hyper-rationalisation du monde, ou plutôt son fantasme parce que la situation échappe à tout le monde, de plus en plus. Il me semble que, pour en rester à notre sujet, l’écologie est un des lieux de déploiement – et générateur – de toutes ces tendances. La démocratie directe bien comprise, c’est-à-dire en tant que source historique d’où nous parlons aujourd’hui mais aussi en tant que théorie et pratique, en tant que praxis, précisément, de cette autre logique, mériterait d’être reprise, et croisée avec tout ce qui se donne actuellement pour ambition de reprendre plus ou moins explicitement la problématique politique.
Lieux Communs
Octobre 2018