« L’idée d’une autre société est devenue presque impossible à penser, et d’ailleurs personne n’avance sur le sujet, dans le monde d’aujourd’hui, même l’esquisse d’un concept neuf.
Nous voici condamné à vivre dans le monde où nous vivons »F. Furet, Le passé d’une illusion, 1995
L’avenir n’est pas terrain vierge, page blanche ou espace vide à combler selon le bon plaisir de chacun. Il est au contraire saturé de notre présent ; bondé de rêves, de fantasmes, de délires, de peurs et d’illusions ; peuplé de monstres et d’anges, de barbelés et de miradors ou de rivières de lait et de miel, de croissance infinie ou de déclin imminent, de fin de l’histoire ou d’horreurs sans fin. L’humanité s’accroche passionnément à ces chimères pour échapper à sa responsabilité vertigineuse d’avoir à faire histoire [1]. Ces figures de l’avenir revêtent aujourd’hui les apparences plus familières de la politique, de l’économie, de l’histoire et de la raison, elles n’en écument pas moins la terra incognita — terre incréée, devrions-nous écrire — qu’est notre futur à l’affût de quiconque s’aventure hors des ornières des discours communément admis.
Ce sont justement ces masques idéologiques qui minent, obstruent et paralysent la réflexion, rendant immensément difficile la formulation d’un projet de société conséquent et faisant de la démocratie directe une risible spéculation. Ce sont eux qu’il faut traquer, déceler, examiner et désarmer, pour livrer l’avenir à son véritable maître, l’imagination. S’ils se déclinent à l’envi, il est possible d’en cerner quelques noyaux en nombre finis. Nous aurons ainsi à répondre d’abord à l’argument glorifiant le statu quo occidental comme indépassable. Puis à son renversement, le catastrophisme paralysant. Viendront ensuite le trope antitotalitaire, puis la posture spontanéiste et enfin toutes les mystifications parareligieuses qui entourent l’utopie.
Pour rendre l’exposé plus accessible, nous prendrons ces figures dans cet ordre inverse de leur apparition au cours de l’histoire, ce qui est en un sens plus logique : c’est celui dans lequel elles se présentent à l’esprit dès qu’il est question d’envisager l’existence d’une société meilleure.
« Bon, mais alors qu’est-ce que vous proposez ? » (Introduction)
Mais il y a, avant toute chose, la question « quelle société proposez-vous ? », qui surgit au sein de toute discussion politique, plus précisément dès que la critique des sociétés contemporaines fait vaciller les certitudes qu’elles inculquent. En ce sens, la question est d’abord et surtout un argument bien plus qu’une interrogation véritable : la difficulté d’une réponse claire est alors censée démontrer l’inanité de la critique du monde existant, et servir de rappel à l’ordre ; inversement, une réponse précise expose immédiatement au soupçon d’autoritarisme, et sert au même rappel à l’ordre. On peut rêver, mais pas entre gens sérieux.
A ce mécanisme de défense, un autre, symétrique, fait écho : « En démocratie directe, les gens décideront de tout... Se projeter dans l’avenir, c’est déjà trahir ses principes... ». Vérité irréfutable — une société autonome n’a de sens qu’en étant l’œuvre continue d’un peuple agissant — mais également parfait sophisme qui instrumentalise la collectivité pour ne pas avoir à se prononcer, soi. Or se positionner, en son propre nom — oui, le sien — sur une meilleure organisation de la société n’est pas un droit, c’est un devoir permanent pour quiconque se réclame simplement du peuple souverain. Et cela est une évidence. Tout comme il est évident que l’affaire est toujours remise au lendemain... On demande, en 1909, à Kropotkine : « Que devrons-nous faire, nous les anarchistes, quand l’ancien pouvoir aura disparu, comme lors de la Commune de Paris en 1871, et que le nouvel ordre ne sera pas encore établi ? » Réponse : c’est une importante question qui n’a pas encore reçu l’attention qu’elle méritait dans le mouvement anarchiste [2]. Disons tout de suite que nous ne voyons pas très bien qui pourrait jeter la première pierre [3]... Car il y a l’extrême difficulté du problème lui-même, mais aussi et surtout, et c’est aveuglant, les résistances extraordinaires à se mesurer à la béance qu’il ouvre, l’emprise des schémas hérités, ces verrous idéologiques qui cloisonnent l’imaginaire des esprits qui s’y affrontent.
Mais le présent texte ne constitue pas seulement une introduction à une tentative de formuler ce que pourrait être une société fonctionnant en démocratie directe — ce qui fera l’objet de la totalité de la brochure suivante [4]. On aurait en effet tort de considérer ces figures comme de simples obstacles subjectifs ou résistances psychologiques qu’il suffirait de faire basculer pour dégager la voie. Car il ne s’agit pas uniquement d’objections préfabriquées par chacun pour maintenir l’État en l’état : ce sont tout autant des bilans implicites tirés des expériences politiques des populations depuis deux ou trois siècles, donc des sédimentations réelles de l’histoire, que seule une criminelle amnésie peut balayer sans phrase [5]. On comprend, à cette aune, la difficulté de l’exercice : il y a à reconsidérer en profondeur ce que nos prédécesseurs entendaient par « société future » et à élucider notre désir de transformations sociale lui-même, qui s’enracine autant dans ce formidable courant dont nous sommes les héritiers que dans les illusions religieuses et idéologiques.
« Ce qui existe est très bien... »
Première figure : Le pro-occidentalisme
Première figure évidente, celle de l’attachement au modèle occidental.
Paradoxe extraordinaire : c’est au moment précis où l’humanité est confrontée à la nécessité vitale d’élaborer d’autres formes sociales ou types de société qu’elle semble incapable de le faire. Tandis que, pendant des siècles, les mondes imaginaires, les sociétés paradisiaques et les villes idéales ont traversé la civilisation occidentale en heurtant — et en transformant profondément — des structures politiques, sociales, culturelles et religieuses qui paraissaient inamovibles [6], l’effondrement actuel de ces dernières n’ouvre sur aucune alternative crédible ou cohérente, et surtout aucune volonté collective d’en établir une. La contradiction n’est qu’apparente ; elle s’explique par la fin des grands conflits politiques et sociaux, l’épuisement historique de la créativité collective et le ralliement final d’une écrasante majorité des populations à l’ordre du monde, y compris lorsqu’elles en sont exclues. Nous disons ralliement, et même adhésion au modèle occidental, aux antipodes du tropisme gauchiste qui persiste à l’occulter derrière « l’Aliénation » des masses, avec cette condescendance paternaliste pour les victimes désignées.
Cette adhésion s’est finalement forgée tout au long des « Trente Glorieuses », ces années d’après-guerre mondiale durant lesquelles le modèle des sociétés « développées » s’est tacitement érigé en finalité de l’histoire humaine. Abondance matérielle croissante, liberté et égalité relatives, État-providence, processus électoraux, effectivité des lois, pacification sociale et extension mondiale : voici les points cardinaux qui ont orienté jusqu’à aujourd’hui le cours des choses, et notamment les voies empruntées par les pays décolonisés ou la direction des flux migratoires. Avancer, dans ce cadre, la simple idée d’une autre société sonne faux, incongru, voire criminel. Cette aimantation des comportements humains, hier si divers selon les continents et les époques, exigerait d’autant plus d’attention qu’elle n’en semble jamais digne pour les pourfendeurs du « Système ». Démêler l’attirance du « modèle occidental » dépasserait le cadre de ce texte mais il nous faut en dire quelques mots, car elle renvoie à la compréhension de l’Occident comme une dualité irréductible, avec d’un côté une quête de puissance, de contrôle, d’accumulation — c’est le capitalisme, la société de consommation et l’inflation technoscientifique — et de l’autre l’émancipation de la société et de l’individu, le refus de la domination et de la ségrégation, la lutte contre l’obscurantisme, la visée d’égalité et de liberté [7].
Règne de l’illimité et attachement aux libertés
Il y a donc d’abord ce mouvement vers ce qu’on peut appeler l’illimité : ce qui est recherché à travers la soif du profit pour lui-même, la consommation frénétique, l’ascension hiérarchique et la recherche de puissance technique, c’est, à l’échelle de l’individu, une fuite hors des limites du monde, de la vie, du temps et du corps, et finalement une négation de la mortalité [8]. Ces limites étaient autrefois rationalisées et ritualisées par les religions, et la puissance demeurait le monopole de divinités inaccessibles. La modernité a fait éclater les premières et s’incarner le désir d’infini dans le monde terrestre, notamment par le truchement des « biens de consommation », sans cesse acquis, renouvelés, consumés, détruits, refabriqués, ou les « nouvelles » technologies promettant ubiquité, omniscience et immédiateté. Or, ces postures anthropologiques sont incompatibles avec le principe démocratique lui-même, qui est exactement l’autolimitation d’un peuple et des individus face à leurs désirs, fantasmes, rêves ou possibilités réelles. Cette disparition progressive de toute commune mesure (hors quelques survivances en milieux populaires) génère un nouveau type d’être humain qui ne semble prêt à renoncer à aucun prix à la promesse d’un paradis terrestre fait d’abondance indiscutable et de bonheur permanent. Sur cette toile de fond, la politique n’apparaît plus que comme une technique gestionnaire visant le bon fonctionnement de la machinerie sociale [9]. Aucun projet de transformation de la société n’aurait donc de sens sinon celui, destiné à soulager nos consciences tourmentées, d’inclure l’humanité entière dans cette infernale course au Progrès.
Il y a ensuite l’autre versant de notre adhésion aux sociétés occidentales : c’est l’attachement aux acquis des luttes antireligieuses, des combats ouvriers, les victoires de la liberté des mœurs, d’expression, l’égalité des femmes, les droits des jeunes, etc. Est-il besoin de préciser ? Cet attachement-là à l’Occident est la base anthropologique de tout projet d’une véritable démocratie : nous ne pouvons que reprendre à notre compte tout ce que les sociétés existantes comportent comme éléments d’autonomie individuelle et collective, de même que ce qui fait qu’elles sont collectivités vivantes et non pas monceau d’individus, ces valeurs d’honnêteté, d’hospitalité, de solidarité et de don qu’Orwell nommait common decency.
Adhésion à la folie de l’accumulation, de la maîtrise, de la puissance, et attachement au principe d’un individu enraciné mais libre et profondément responsable sont deux composantes de l’Occident étroitement entremêlées en chacun d’entre nous, et pourtant distinctes. C’est l’absence de ce distinguo qui a poussé les marxistes, puis leurs héritiers gauchistes d’aujourd’hui, à disqualifier ces droits comme « libertés formelles » faisant le jeu des puissants (!) ou à les moquer comme ethnocentrismes [10], mais surtout à les fouler aux pieds dans leurs pratiques quotidiennes, à l’échelle de nations ou de groupuscules. C’est bien l’histoire du XXe siècle qui pousse alors les populations à associer intuitivement tout projet de changement social à une table rase, où seraient définitivement perdues ces libertés patiemment acquises au fil des siècles — et il est difficile d’écrire que ce n’est pas à raison.
La désintégration vertigineuse de cet héritage, partout visible sous la figure de « droite » de l’oligarchie ou celle de « gauche » du relativisme « multiculturel », ne peut que rendre plus impérieuse la tâche d’en reprendre le flambeau, et d’élaborer une perspective révolutionnaire en continuité avec ces luttes pluriséculaires.
« De toute façon, c’est bientôt la fin du monde ! »
Deuxième figure : Le catastrophisme
Dès que vacille l’image d’un modèle occidental viable, stable et extensif à la planète, la seconde figure prend immédiatement le relais : la certitude impuissante de l’effondrement prochain du monde civilisé, récemment scénarisé par l’industrie du spectacle.
De même que la « vie privée » est vécue en Occident comme une oasis au milieu d’un désert surpeuplé et hostile, l’époque présente est perçue comme une parenthèse historique de calme relatif entre deux déferlements de bruit et de fureur. La situation actuelle est vécue comme l’œil du cyclone, qu’illustre parfaitement la relation des populations françaises au confort électrique fourni par l’énergie nucléaire dite civile — que l’on sait pourtant parfaitement suicidaire. Dans ce cadre catastrophiste [11], hormis les fantasmes primitivistes [12], nulle place pour un regard vers l’avenir : tout projet politique sonne aussi creux que de soulever la question du sexe des anges sur le pont incliné du Titanic.
La tentation écofasciste
Comme la précédente, dont elle constitue l’exact revers de médaille, cette posture est l’évitement d’une situation effectivement inquiétante, où l’on voit la montée en puissance de « crises » multiples, à la fois sanitaires, énergétiques, écologiques, fortement imbriquées aux crises sociales, politiques, culturelles et anthropologiques. Dans ces perspectives, un projet de démocratie directe prend une couleur toute particulière : tout pousserait plutôt à faire valoir autoritairement la survie biologique de l’espèce, à reléguer toute préoccupation politique au rang du luxe exorbitant, sinon de l’irréalisme coupable. Cette tendance, souterrainement bien plus répandue qu’on ne le pense, est un soutien à l’oligarchie dominante. Elle repose finalement sur le postulat fondamental de celle-ci, qui veut que l’individu ne puisse se préoccuper que de ses seuls intérêts particuliers et que la gestion de la chose publique soit, au fond, une affaire de spécialistes. Et son prolongement naturel est un horizon où l’écologie « scientifique » servirait de colonne vertébrale à un régime autoritaire. La réfutation de la politique comme science, epistémè, au profit de la confrontation des opinions, doxa, a été faite ailleurs [13] : bornons-nous ici à en montrer concrètement la pertinence.
Sobriété et égalité
L’enjeu fondamental, à la fois psychique et matériel, des décennies à venir est la baisse drastique du « niveau de vie » économique des pays riches, et l’arrêt de l’accession à ce modèle, au « développement », pour les pays pauvres. Cette évidence est masquée par un cloisonnement disciplinaire, aux deux sens du terme : la séparation militante des traitements de la crise économique et de la crise écologique. D’un côté, le discours égalitariste « anti-oligarchique » se fait toujours dans une perspective d’abondance pour tous. Il s’inscrit dans la grande tradition redistributive de toutes les utopies « socialistes », qui entretenaient le mythe d’un productivisme impliquant l’extraction illimitée des « ressources » naturelles [14]. De l’autre côté, le discours écologique le moins inconséquent parie sur une « décroissance » salutaire, mais qui réduit l’ampleur des transformations politiques à effectuer à un simple changement des mentalités individuelles [15], sans véritablement renouer avec l’héritage des luttes égalitaires. Ces deux discours se croisent sans parvenir à joindre la critique de la fascination pour l’abondance matérielle et le refus du pillage oligarchique. Lorsqu’on sait qu’anthropologiquement, les modèles comportementaux émanent des élites [16], il est clair que lutter contre l’adhésion à la société de consommation ne peut réellement se faire qu’avec la fin de la domination généralisée. La sobriété ne pourra être vécue humainement que dans une société strictement égalitaire. La redéfinition collective des besoins est inséparable, par définition, de l’égalité politique et sociale qu’exige une démocratie directe.
Science et démocratie
Quelques mots sur l’avenir le plus probable, et son impasse. Le discours scientiste de l’économie a dominé la pensée politique du XXe siècle et a été massivement répandu par le marxisme. Tout semble indiquer que le discours écologique prend le relais pour le XXIe : au-delà de la simple phraséologie autour du « développement durable », la fonction principale de cette idéologie est de continuer à confisquer le droit de décision au plus grand nombre à partir d’un chantage à la survie. Mais la perspective d’un régime dirigé par un cercle de scientifiques mêlant technocratiquement « ingénierie sociale » et « génie écologique » resterait totalement aveugle quant au processus social sur lequel reposent et la science et l’écologie, se condamnant de ce fait à l’inefficacité de son propre point de vue. Car, pas plus que le marché, le travail scientifique véritable n’a jamais été une sphère détachée de la société : il ne naît et n’existe que dans et par une collectivité où les questions même les plus farfelues sont ouvertes, où l’individu entretient avec le monde naturel et social une relation problématique et peut porter des interrogations, mener des investigations et imaginer des hypothèses dans tous les domaines. La science, en tant qu’interrogation rationnelle et pratique sur l’univers, est partie prenante du projet d’autonomie et en est même un des centres. Et le tarissement de l’imagination créatrice à laquelle nous assistons depuis des décennies affecte autant le terrain des luttes sociales que les laboratoires de recherche. Ce qu’il faut bien appeler aujourd’hui le délire technoscientifique n’est en rien une communauté mondiale de gens libres dégageant des vérités partielles et fragiles dans la confrontation mutuelle : la « Science » est devenue un agrégat d’intérêts cloisonnés plus ou moins dérisoires, soumis au lobbying intensif des industriels et des États, où les crédits décident des directions de recherche, et les clans des carrières [17]. La question n’est plus de savoir s’il existe encore une véritable recherche scientifique (la réponse est assez claire, qu’il s’agisse de sciences sociales ou d’agronomie [18]), mais si ce que l’on nomme ainsi sera à la hauteur des attentes croissantes dont elle est l’objet.
Démarche scientifique et constitution d’une société vivante et ouverte vont de pair. La chose est particulièrement évidente concernant l’écologie scientifique, dont l’objet d’étude est l’ensemble dynamique des interactions entre les sociétés mondialisées et leurs environnements biophysiques. Une telle discipline, destinée à un « brillant » avenir, doit analyser une biosphère en perpétuel changement, particulièrement sous des pressions anthropiques permanentes : elle ne peut par définition qu’impliquer non seulement toutes les autres sciences, y compris et surtout celles dites humaines ou anthropologiques, mais également les processus mêmes des décisions collectives, puisque, laissée à elle-même, elle se trouve ontologiquement incapable de dessiner un quelconque projet pour l’humanité. C’est sur cette impasse qu’achoppent aujourd’hui toutes les réflexions bio-éthiques ou philosophiques concernant la course actuelle de la technoscience (bio-ingénierie, nanotechnologie, génie génétique, etc.), livrée à sa propre dynamique en l’absence de toute expression populaire [19] — et les cénacles de « sages » ne constituent qu’une manœuvre dilatoire.
Les changements accélérés et tous azimuts que connaît la fine couche de vie terrestre comprise entre le vide interplanétaire et le sous-sol magmatique n’impliquent en rien un abandon de la perspective démocratique : ils l’exigeraient plutôt. Car le rapport à la « Nature » est ce qu’il y a de plus « imaginaire » dans une société, et la possibilité de changer celui-ci, de critiquer et d’altérer ses propres significations sociales (valeurs, comportements, principes, etc), est sans doute la définition la plus précise de l’entreprise démocratique. Qu’il s’agisse de la pénurie de ressources naturelles, de l’apparition de nouvelles souches pathogènes, de la montée du niveau des océans, d’une démographie incontrôlée ou d’une catastrophe nucléaire, les réflexions les plus récentes et les plus pertinentes sonnent comme un appel à des sociétés capables de combiner la multitude innovante des individualités et les moyens de coordination / coercition d’instances politiques globales [20]. Aucune situation ne peut plus permettre de faire durablement l’économie d’une intelligence collective liant savoir savant et savoir profane, gestes quotidiens et mesures planétaires. On retrouve ici, appliquée à la relation à la culture, à la connaissance, au savoir et à la science, la célèbre formule d’Aristote résumant le type anthropologique du citoyen démocratique, « capable de gouverner comme d’être gouverné ».
(.../...)




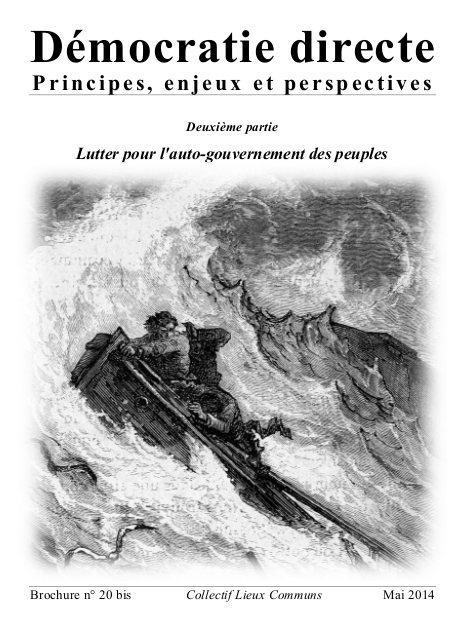

Commentaires